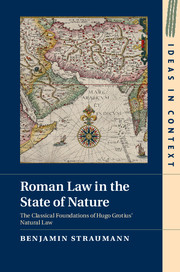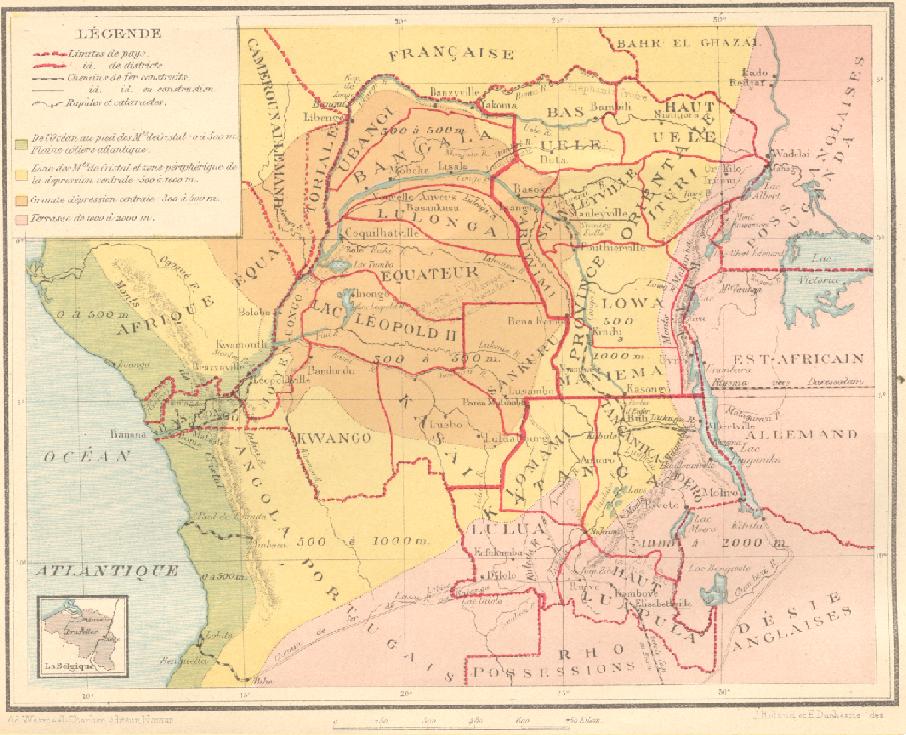announced the following conference, of interest to researchers in world history and comparative public legal history.
L’intérêt suscité par la question de la
souveraineté indigène ne serait-il jamais autre chose que le goût de
l’historien envers « la beauté du mort » pour emprunter cette expression
à Michel de Certeau évoquant, en 1970, les travaux des hommes du XIXe siècle et ceux de ses contemporains sur la culture populaire et le folklore ? Il écrivait, en effet, que « la culture populaire
suppose une opération qui ne s’avoue pas. Il a fallu qu’elle fût
censurée pour être étudiée. Elle est devenue alors un objet d’intérêt
parce que son danger était éliminé ».
La souveraineté indigène perçue donc comme un danger en effet car elle est, in fine,
un obstacle à la politique de conquête alors menée durant ces cinq
siècles par les puissances européennes atlantiques (Provinces-Unies et
Suède comprises) depuis la grande scène inaugurale du 12 octobre 1492
quand bannières au vent, Christophe Colomb et les Espagnols qui ont
traversé la mer Océane débarquent théâtralement sur l’île de Guanahani,
première île du continent américain, dont ils prennent possession au nom
des souverains d’Espagne, qui les ont mandatés au mois de mars
précédent. Les officiers présents, oubliant leurs rancœurs liées aux
difficultés de la traversée, jurent allégeance à l’Amiral de la mer
Océane, représentant des Rois Catholiques. La rencontre avec les peuples
indigènes s’inscrit dans la volonté du Génois d’imposer la souveraineté
espagnole, considérant que cette dernière supplantait une quelconque
souveraineté susceptible d’exister en ces îles. Dès lors, les puissances
européennes cherchent à justifier la souveraineté sur une terre par sa
découverte ou son appropriation, qui se fait progressivement au cours
des siècles suivant les premiers contacts en Amérique.
Une menace dont l’élimination
(ou « l’usurpation » pour reprendre l’expression du juriste Michel
Morin en 1997) procède d’un double combat mené par les armes et par les
plumes tant semble irrésistible la volonté de faire de ces terres
étrangères des territoires vierges frappés du sceau du dénuement. Des terra nullius
présentées si désertes que même la belle lucidité d’un Montaigne sera
prise en défaut, reprenant, dans l’essai « Des cannibales » (Essais, I, 31), les topoï du temps sur la nudité américaine – largement diffusés au travers des éditions des Décades
de Pierre Martyr d’Anghiera. Quelques années plus tard, l’iconologie de
Cesare Ripa présente les quatre continents comme autant de variations
autour d’une Souveraineté que l’on peut admirer dans son affirmation
triomphante (l’Europe), déclinée ensuite dans des euphémisations
progressives – l’Asie puis l’Afrique – jusqu’à son complet évidement
avec l’Amérique. Dans la fameuse allégorie America, gravée dans
les années 1580 par Theodor Galle d’après un dessin de Jan van der
Straet, dans laquelle Amerigo Vespucci est montré comme réveillant
l’Amérique dormante, ce dénuement est dramatiquement mis en scène dans
le contraste entre l’Européen, debout et caractérisé par le mouvement
que sa station interrompt seulement l’instant d’un souffle ou d’un
étonnement, et l’Amérique, aussi pauvre et nue de vêtement que
précédemment inerte.
Toutefois la
souveraineté indigène ne se réduit pas à cette propice absence et les
explorateurs européens n’auront de cesse, pour la plupart d’entre eux,
de rencontrer des « rois », de poursuivre la trace des royaumes indiens
de Saguenay et Norembegue, d’atteindre les Sept Cités, de marcher à
rebours sur les traces des rois mages pour gagner la mythique Ophir ou
retrouver Seba quand ils ne buttent pas, un temps, sur de solides
empires au Mexique et au Pérou dont ils peuvent moins nier la
souveraineté qu’ils espèrent, précisément, la soumettre aux vrais rois,
espagnols et chrétiens, ou de manière plus modeste, celle par exemple
des Algonquins de l’Amérique française avec lesquels passe alliance
Samuel de Champlain. Ou encore admirer de puissants rois amérindiens,
dignes des Illustres antiques et des héros contemporains, comme
Satouriona, « roi de Floride », ou le colosse Quoniambec figurés dans
les Vrais portraits et Vies des hommes illustres de Thevet. Ou même faire de ces rois américains des mages bibliques comme dans une célèbre Adoration des mages,
vers 1505, attribuée au Maître de Viseu, ou, à rebours les figures
grimaçantes du souverain des Enfers…, images saisissantes alors d’une
souveraineté indigène chahutée d’un bout à l’autre d’un large spectre
allant de sa destruction sous des modalités diverses à sa préservation
ou sa recomposition ambigüe en passant par son ignorance et la
négligence de ses réalités.
Dans le cas de
l’Afrique c’est un autre rapport qui s’établit. Cet immense continent
est présent dans l’imaginaire européen depuis l’Antiquité, pourtant les
explorations portugaises du XVe siècle recomposent un nouvel
objet et dessinent une logique différente où la place de la
« souveraineté » telle qu’elle est entendue en Europe joue un rôle
essentiel et peut susciter une configuration particulière associant
droits traditionnels sur un espace et des populations et droit sur une
activité comme en témoigne en 1486 la titulature de Jean II du Portugal.
Dans un premier temps, elle peut ne pas être reconnue. Ce qui donne
lieu aux premières rafles d’esclaves d’Afrique de l’Ouest racontées par
Gomes Eanes de Zurara dans sa « Chronique de Guinée » (1453). Au fur et à
mesure que les peuples rencontrés sont identifiés dans l’imaginaire de
l’époque et que des distinctions s’établissent dans la lignée classique
médiévale entre « Infidèles », « Maures » ou encore « Maures Noirs »,
l’émergence d’une souveraineté indigène devient possible et le roi du
Saloum peut se faire appeler le « Père des Blancs ». Cette
reconnaissance sert de barrage à l’accès des Européens à l’intérieur
africain comme le montre l’exemple, tardif, d’un souverain du Galam qui
refuse l’installation pérenne des Français dans les terres en question.
La confrontation des réalités portugaises en termes de souveraineté, en
terres américaines et africaines, rend compte également de la nécessité
de comprendre les modulations de la souveraineté indigène au sein d’un
même espace colonial.
La Conquête,
justifiée par l’entreprise d’évangélisation, a, semble-t-il, effacé
toute forme de souveraineté indigène dans l’espace américain revendiqué
par les empires ibériques aux Amériques. Si, dans le domaine de la foi,
les rois d’Espagne imposent la conversion à leurs nouveaux sujets, ils
s’inscrivent, sur le plan politique, en continuité avec les anciennes
polités amérindiennes. Avec la construction coloniale des deux
républiques au sein de la Monarchie catholique, celle des Espagnols et
celle des Indiens, avec la reconnaissance de noblesses indigènes par les
institutions monarchiques dès le XVIe siècle, et la
reconnaissance d’une administration autonome des communautés indiennes
par des caciques et principaux, c’est une forme de souveraineté
relative, subalterne, qui est reconnue aux Indiens, comme élément à part
entière d’une monarchie polycentrée. De fait, la Conquête est loin
d’avoir éteint toute forme de souveraineté indigène, y compris à
l’intérieur des empires européens, si l’on donne à ce concept, au
rebours de sa conceptualisation bodinienne, un sens relatif et
imparfait. De nombreux exemples témoignent de ces formes de
gouvernements des Indiens par eux-mêmes à l’intérieur des empires
chrétiens, comme la République de Tlaxcala, dont l’autonomie à
l’intérieur de la Nouvelle-Espagne était justifiée par l’aide reçue par
Cortès aux heures de la Conquête, Pátzcuaro, ou l’alliance avec les
nations ou villages indiens en Amérique du Nord « française ». Des
relations diplomatiques continues, aux marges des empires, attestent la
reconnaissance de facto de polités indigènes, comme en témoigne encore l’institution du parlamento entre
le capitaine général du Chili et les Indiens Araucans (Mapuche) tout au
long de la période coloniale, ou les alliances commerciales ou
militaires entre les Six-Nations iroquoises et les Britanniques. Ce
n’est, d’ailleurs, qu’au cours du XIXe siècle que les
dernières polités amérindiennes indépendantes furent conquises par les
armes : Comanches, Apaches, Sioux des plaines ; Chiriguanos de l’Est
bolivien ; Mapuches et Indiens de Patagonie dans ce qui deviendrait, à
la fin du siècle, le Sud du Chili et de l’Argentine. Les empires
européens, et les Etats indépendants qui leur ont succédé, et qui les
ont souvent continués, ont ainsi construit un spectre complexe de
relations avec les formes de gouvernements indigènes qu’ils
autorisaient, reconnaissaient ou combattaient : co-construction
impériale, sous le signe théorique d’une souveraineté européenne absolue
dans ses prétentions mais aménagées dans ses pratiques comme en
Nouvelle-France dans le cadre de l’alliance et de la protection ;
transformation et incorporation des polités amérindiennes, avec lutte
contre les Indiens des marges pour l’Espagne ; guerre et relations
diplomatiques et commerciales pour la Grande-Bretagne ; incorporation à
la citoyenneté pour les jeunes républiques hispano-américaines mais
alliances, conflits et, au final, déportations ou ethnocides au sein des
empires républicains en expansion au Nord et au Sud du continent, etc.
Sur les plans du
droit, de l’imaginaire politique, des représentations culturelles et des
savoirs scientifiques, la discussion a été continue sur la définition,
les limites et la valeur de ces souverainetés indigènes, qu’elles
fussent relatives ou absolues. Cette réflexion de longue durée sur la
nature des polités indigènes, la grandeur ou la barbarie des empires
précolombiens, la dégénérescence ou la bonté naturelle des Indiens,
donna lieu à la construction d’épistémologies et de savoirs dès le XVIe
siècle. Si le débat sur les justes et injustes titres de la conquête
fut l’un des éléments fondamentaux de la formation du droit moderne des
gens, une forme naissante d’anthropologie historique naît avec les
ouvrages qui évoquent les empires défunts des Aztèques ou des Incas
(Inca Garcilaso de la Vega, Sahagún, Motolinía, etc.). Il faut
souligner, avec Jorge Cañizares-Esguerra, l’importance de la controverse
de l’Amérique, au XVIIIe siècle, pour l’épistémologie, ou
l’une des épistémologies, des Lumières : le Nouveau Monde devait-il être
connu à travers une histoire naturelle, ou l’histoire tout court ? Dans
le second cas, la redécouverte des Antiquités américaines, et de la
grandeur des empires précolombiens, devenait le support d’une réflexion
anthropologique et historique sur les relations entre l’Europe au reste
du monde. Pour les Européens, du Vieux ou du Nouveau Monde, la
« Découverte » et la Conquête ont longtemps servi à penser le rapport à
l’altérité anthropologique et politique : les souverainetés indigènes
peuvent être comprises, ainsi, comme le lieu d’un travail symbolique où
naissent des savoirs nouveaux dans les domaines du droit, de l’histoire,
de la science politique, de l’anthropologie concernant le processus
d’occidentalisation. Les Indiens, et leurs souverainetés vaincues,
représentent, dans cette histoire, le spectre d’une altérité défaite,
inoubliable, qui hante la conscience occidentale.
Le colloque se
propose dès lors de dresser un état des lieux du sujet pour rassembler
autour de la souveraineté indigène des chercheurs en sciences humaines
et sociales et en droit notamment, afin de saisir les constructions
parallèles et associées de la souveraineté des deux côtés de
l’Atlantique entre la fin des universaux médiévaux et leur régime de
gouvernance au cours des XVe et XVIe siècles et
les lendemains des expériences politiques des « Révolutions
atlantiques » inaugurant de nouveaux rapports à l’Autorité dans la
première moitié du XIXe siècle. Ce regard doit être
considéré, en effet, moins comme inerte ou s’attachant à la seule
description immunisante d’une extériorité exotique que partie prenante,
de manière fondamentale, d’une construction singulière de la
Souveraineté moderne européenne elle-même dont la mise en place est
profondément associée aux questionnements provoqués ou renouvelés par
ces nouveaux horizons du monde, géographiques, religieux et politiques.
.